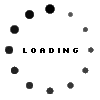Ur veaj dañjerus (traduction ci-dessous)
Dont a reas ar bloaz 1870 hag a grogas d’ar mare-se ar brezel etre ar Brusianed hag ar Frañsizien.
Un deiz, war-dro fin ar bloaz, he doa bet ma mamm-gozh gourc’hemenn, a-berzh an ti-kêr, da gas daou garr da Vontroulez da gerc’hat fuzuilhoù evit soudarded yaouank.
Ar re-mañ a oa o teskiñ ober brezel e Kastellin, a-barzh bezañ kaset da stourm a-enep ar Brusianed a oa en em gavet don e bro C’hall. Ar fuzuilhoù, moarvat, a oa armoù kozh, deuet eus Bro Amerika . Eno e oant bet en implij dek vloaz bennak kentoc’h, p’emede Abraham Lincoln e penn ar Stadoù Unanet, e-pad ar brezel a zirollas etre ar re a glaske rein o frankiz d’ar vorianed sklavourien hag ar re a oa a a-enep.
Lakaat a reas ma mamm-gozh sterniañ daou loen-kezeg,unan ouzh pep karr, hag ez eas ar mevel gant unan eus ar c’hirri ha Chañ-Mariou ar Gow, ar verc’h yaounkañ,gant egile, eviti da gaout neuze nemet trizek vloaz.Hag int etrezek Montroulez, e-lec’h ma tigouezhjont diwezhat diouzh an abardaez, goude bezañ graet pemzek lev dre un hent tenn, a-dreuz ur vro digompez ha dre un amzer griz, liv an erc’h warni.
Antronoz-vintin, goude bezañ lojet e kêr, ez eas an daou charretour, da glask penn eus ar fuzuilhoù. Hogen ret e oa dezho redek eus an eil burev d’egile hag ober kement a sifroù, a-barzh kaout an armoù, ma ne c’helljont bezañ karget dezho ar c’hirri nemet diwezhat goude kreisteiz. Ha pa guitajont kêr Vontroulez , war-dro peder eur diouzh an abardaez , emede an noz o tostaat. Neuze, avat, e oa ur gwall-c’hoari rak, p’en em gavas ar c’hirri e-kreiz ar sav vras a zo diouzhtu er-maez eus kêr, e kouezhas frim ha kazarc’h.
Riellañ a rae an hent hag ar c’hezeg, o riklañ war ar glerenn, a ginnige kouezhañ bep kammed a reent. Dav e oa d’ar mevel ha d’ar grennardez, diskenn eus ar c’hirri da gregiñ e penn o loened ha da glask ur marichal da lakaat d’ar re-mañ tachoù-sklas. Goude e kendalc’hjont gant o hent, atav war o-zroad, rak, daoust d’an tachoù-sklas, e rikle c’hoazh ar c‘hezeg.
A-benn neuze e oa teñval-sac’h an noz. An erc’h, o kouezhañ didrouz ha pounner, a lede, war an hent hir hag enkrezus ha war ar gwaremmoù lann tro-dro, ur vantell gwenn-kann, re-bar d’ur mell liñsel o sebeliañ ar bed. Siwazh ! ne dave tamm ha stankoc’h-stankañ, koulz lavaret, e nije ar pluennoù skañv, o tiskenn goustatig hep ehan.
Diaes-bras e oa d’an daou charretour bale gant an erc’h a dapas dezho dizale betek hanter o c’hov-karr .Gleb o zreid en o botoù ha brevet o c’horf oc’h ober hent, e kerzhent ruz-diruz e-kichen o c’hezeg.
Ur nozvezh spontus a dremenjont e-kreiz ar menez. Skuizh-divi e oa ar plac’hig hag ivez ar mevel, un den yaouank ha kreñv koulskoude, gant ar bec’h hag ar c’housket. Gwall-brederiet e oant ouzhpenn ha nec’het gant ar soñj ne vije ket an daou jav, marteze, evit mont da benn ar veaj hag e chomfe loc’het ar c’hirri war an hent, e-touesk an erc’h. Bep ur mare e raent un harp da zistagañ ar botezadoù erc’h a yae da heul o zreid, hag evit rein amzer d’an daou varc’h d’ober un tenn alan. Hogen neuze, e skorne o izili gant ar riv, hag e teue ar c’hwezenn a bizenne war o zal da drein e beradoù dour sklas hag e tammouigoù kler. Hag e veze dav lavaret « Yao ! » adarre, pe chom da gleñvel gant ar yenijenn war klaz an hent bras. E bourk Pleiben e tigouezjont war-dro tarzh-an-deiz, rak, evel ma lavaret amañ : « Forzh da vale, e reer roud hep dale ».
Neuze goude bezañ torret o naon ha graet un diskuizh, e kerzhjont, daoust d’ar rust-amzer ha d’an erc’h, tavet un nebeut evit gwir, da benn ar veaj.
Eno emede bataillon Gastellin o c’hortoz, gant mall, an daou garrad fuzuilhoù…
Hervez ma maeronez , e oa bet, er bloaz-se, ur goañvezh eus ar gwaskañ, hag o devoa kalz Bretoned da c’houzañv leizh o c’hroc’hen e kamp Koñli. Darn anezho, skuizh oc’h ober bouzelloù voan hag o pilpasat er pri hag er vouilhenn, el lec’h displijus-se anvet ganto « Kerfank »,en em vodas ur wechad hag a dreuzas ar c’hamp o youc’hal a-bouez penn : « Finister,d’ar gêr ! Finister, d’ar gêr ! » Bez e oa eno ofisourien na ouient ket ar brezhoneg hag a gredent e c’houlenne hor c’henvroiz mont d’en em gannañ. Ha n’eo ket souezhus rak « <gêr », e brezhoneg, a vez distaget evel « guerre » da lavaret eo « brezel », e galleg. «A ! »,emezo, «paotred kalonek eo re ar Finister, avat, pa’z eus kement a vall warno da vont da vrezeliñ ! »
Pennad eus al levr « E skeud Tour Bras Sant Jermen » (p22,23,24)
Yeun ar Gow (né à Pleyben en 1897 mort à Gouezec en 1966)
Un voyage dangereux
Nous sommes en 1870 et la guerre avait éclaté à cette époque entre les Prussiens et les Français.
Un jour, vers la fin de l’année, ma grand-mère avait reçu l‘ordre de la mairie de conduire deux charrettes à Morlaix pour aller chercher des fusils destinés à de jeunes soldats.
Ceux-ci apprenaient, à Châteaulin, le maniement des armes avant d’être envoyés se battre contre les Prussiens qui avaient pénétré profondément dans le territoire français. Les fusils étaient apparemment de vieilles armes venues d’Amérique. Elles avaient été utilisées là-bas, une dizaine d’années auparavant, lorsqu’Abraham Lincoln était à la tête des Etats-Unis, pendant la guerre qui éclata entre ceux qui voulaient donner la liberté aux esclaves noirs et ceux qui s’y opposaient.
Ma grand-mère attela deux chevaux, un à chaque charrette. Le domestique prit l’une d’elle et Chañ Mariou ar Gow, la plus jeune des filles, prit l’autre, alors qu’elle n’avait que treize ans seulement.
Et les voilà partis à Morlaix où ils arrivèrent tard le soir, après avoir parcouru quinze lieues sur une route difficile, dans un terrain accidenté, par un temps gris, d’une couleur qui annonçait la neige.
Le lendemain matin, après avoir dormi en ville, les deux charretiers allèrent prendre possession des armes. Mais il leur fallut courir d’un bureau à l’autre et attendre que le décompte fut fait avant qu’elles leur soient confiées si bien que les armes ne purent être chargées dans les charrettes que tard dans l’après-midi. Et lorsqu’ils quittèrent Morlaix, aux alentours de quatre heures du soir, la nuit commençait à tomber.
Ce fut alors une autre histoire, car, lorsque les charrettes s’engagèrent au milieu de la grande côte, juste à la sortie de la ville, il se mit à tomber du grésil et de la grêle. Le verglas commença à se former sur la route et les chevaux, qui glissaient sur le sol glacé, menaçaient de tomber à chaque pas.
Le domestique et la fille furent contraints de descendre de leurs charrettes afin de prendre les chevaux par la bride et durent aller chercher un maréchal-ferrant pour ferrer les bêtes avec des fers munis de clous. Ils poursuivirent leur route, toujours en marchant, car malgré les fers cloutés, les chevaux glissaient encore.
Il faisait maintenant nuit noire. La neige lourde qui tombait en silence recouvrait une route longue et angoissante, ainsi que les landes aux alentours, d’un manteau d’un blanc éclatant, semblable à un gigantesque linceul ensevelissant la terre. Hélas, cela ne s’arrêtait pas et les flocons, tels des plumes légères, tombaient lentement sans discontinuer et de plus en plus serrés.
Les deux charretiers progressaient avec la plus grande peine face à cette neige qui atteignit bientôt jusqu’à près de la moitié de leurs mollets. Ils avaient les pieds trempés dans leurs sabots et leurs corps étaient épuisés par cette marche forcée à côté de leurs chevaux.
Ils passèrent une nuit épouvantable au milieu de la montagne. La fille et le domestique, un homme jeune et fort pourtant, étaient éprouvés par les efforts effectués et le manque de sommeil. Ils étaient de plus très soucieux et inquiets en pensant que les deux bêtes ne pourraient aller jusqu’au terme du voyage et que les charrettes resteraient là, sur la route, coincées dans la neige.
Ils s’arrêtaient, de temps en temps, pour enlever la neige qui rentrait dans leurs sabots et pour donner aux chevaux le temps de reprendre leur souffle. Mais alors, leurs membres se mettaient à geler avec le froid et la sueur qui perlait sur leurs fronts se transformait en gouttelettes gelées et en petits morceaux de glace. Et il fallait encore crier «Yaou !» ou alors on restait là avec le risque de prendre froid au fond de ce chemin. Morts de fatigue, tout autant que leurs chevaux, ils parvinrent au bourg de Pleyben à l’aube, car comme on dit ici : « A force de marcher on fait son bonhomme de chemin ».
Alors, après avoir mangé et s’être un peu reposés, ils arrivèrent, malgré le mauvais temps et la neige qui s’était alors un peu calmée, au terme de leur voyage.
Le bataillon de Châteaulin était là, attendant avec impatience, les deux cargaisons de fusils.
Selon les dires de ma mère, l’hiver a été cette année-là, l’un des pires que l’on eût à connaître et beaucoup de Bretons ont eu à endurer dans leur chair l’humidité du camp de Conlie. Une partie d’entre eux, fatigués par les privations, piétinant dans l’argile et la boue, en ce lieu détestable qu’ils avaient appelé « Kerfank » se rassemblèrent un jour et traversèrent le camp en criant à tue-tête : « Finister, d’ar gêr ! Finister, d’ar gêr ! »(1). Il y avait là des officiers qui ne connaissaient pas le breton et qui crurent que nos compatriotes demandaient à aller se battre. Et ce n’est pas surprenant car « gêr » en breton est prononcé comme « guerre » en français. « Ah ! » dirent-ils « les gars du Finistère sont vraiment courageux, à ainsi tant vouloir aller se battre ! »
Traduction YK miz Mae 2019
- « Finistère, à la maison ! Finistère, à la maison ! »